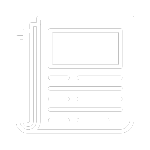« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples »
(Jean 13,35)
« Que votre joie soit parfaite »
(Jean 15, 11)
BIENVENUE SUR LA PAROISSE
LES ACTUALITES DE LA PAROISSE
à retrouver sur l’application Oclocher
LES ACTUALITES DE LA PAROISSE
Albums photos des évènements de la paroisse
LES ACTUALITÉS DU DIOCÈSE
Jeunes à Lourdes : « un beau signe d’espérance ! »
Il nous faut "prier pour que le coeur des jeunes s'ouvrent" Cette semaine le père François Bidaud nous parle pèlerinage et rassemblement : Lourdes, 1er mai et Ecole de prière. Le pèlerinage diocésain à Lourdes vient de débuter. Un beau rassemblement avec plus de...
« Curé : c’est une attitude missionnaire ! »
Nous avons cette année 7 changements dont deux nouveaux curés Aujourd’hui le père Robert Daviaud revient sur les nominations publiées ce dimanche, la formation sur le mécanisme d’emprise du 9 Avril et le document « Dignitas infinita » publié par le dicastère pour la...
Déclaration « Dignitas Infinita » sur la dignité humaine
"L’Église proclame l’égale dignité de tous les êtres humains, quelles que soient leur condition de vie et leurs qualités." Le Vatican, par la voix du préfet du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, a publié un texte sur la dignité humaine, le 7 avril 2024, pour...
LES SACREMENTS
Découvrez les différents sacrements célébrés dans la paroisse Notre-Dame de Luçon.
Messe info
Horaires et permanences
Restez informé :
SA NEWSLETTER

UN GUIDE PAROISSIAL

L’APPLICATION OCLOCHER

AGENDA DE LA PAROISSE
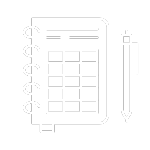
LE BULLETIN PAROISSIAL